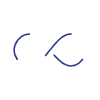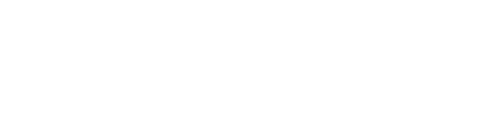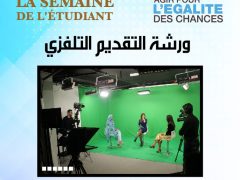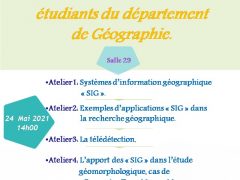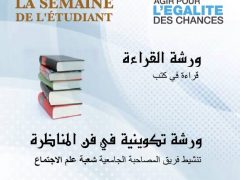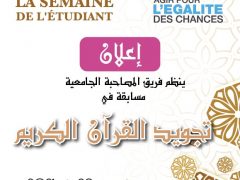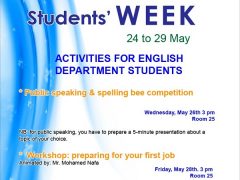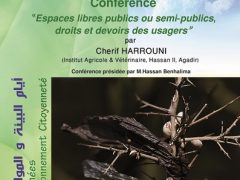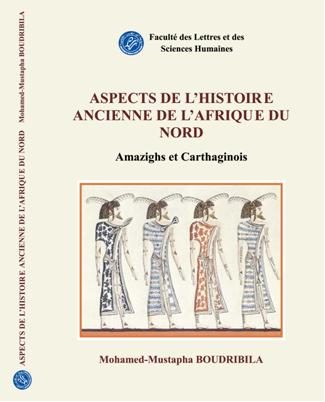
ASPECTS DE L’HISTOIRE ANCIENNE DE L’AFRIQUE DU NORD – Amazighs et Carthaginois
L’étude de l’histoire ancienne de l’Afrique du Nord est à la fois complexe et compliquée. Cette situation émane de la rareté des documents écrits et du désintérêt des historiens nord africains pour cette période ; ce qui a conduit plusieurs auteurs européens, pour la plupart des Français, à formuler des théories, plus au moins fantaisistes tant sur la toponymie du pays que sur les origines de ses anciens habitants. Ce qui a aboutit à des hypothèses qui cautionnent l’idée d’une ancienne immigration de populations asiatiques ou orientales et européennes en Afrique du Nord. Ces auteurs se sont donnés beaucoup de mal dans le but d’appuyer les textes anciens et de démontrer que le peuple qui a façonné la civilisation amazighe n’est pas issu de l’Afrique du Nord; mais de l’Asie ou de l’Europe. Le désir d’expliquer l’ancienne présence celtique et donc française les a incités à essayer de présenter les anciens amazighs comme étant incapables de créer leur propre culture ou même d’inventer leur écriture.
Cependant, il est à constater qu’à partir de la deuxième moitié du dernier siècle, l’intérêt des chercheurs nord-africains est devenu presque une mode. Cet intérêt revient d’une part à l’émergence du mouvement amazigh qui a pris naissance au milieu du siècle dernier en Algérie et s’est propagé ensuite sur le reste des chercheurs maghrébins. D’autre part, grâce à l’évolution des sciences et disciplines dites sciences auxiliaires de l’histoire telles que l’archéologie, l’épigraphie, l’anthropologie, la linguistique, la philologie, l’histoire de l’art et d’autres disciplines encore.
Notre intérêt se porte, en quelque sorte, sur la révision de cette histoire ancienne de l’Afrique du Nord. Il nous a paru donc évident de rassembler le maximum d’éléments qui concernent de près ou de loin ces anciens amazighs : leurs origines, leur mode de vie, leurs organisations socioculturelle, politique et religieuse.
Certes grâce à l’archéologie, on est relativement mieux renseigné aujourd’hui qu’il y a plus d’un demi siècle sur certains aspects de l’histoire ancienne de l’Afrique du Nord : sur la colonisation phénico-punique, l’urbanisme, la vie économique à l’époque des rois amazighs et des Romains.
Mais, il faut se rendre à l’évidence que la majorité des recherches archéologiques ont été centrées sur les groupements urbains, et de ce fait on ne sait rien du monde rural et nous ignorons encore beaucoup de la vie des citadins, de leur identité, leur organisation sociale, culturelle, économique et politique. Les études faites et reproduites au début du XXème siècle ont été révisées et nuancées par de nouveaux chercheurs et, peu de nouveau a été réalisé.
On ne connaît pas encore la date des royaumes amazighs. Comment et en quelles circonstances ont-ils émergé? S’agit-il d’un résultat de résistance ou d’une évolution interne ? Et quels rapports a-t-elle eu l’Afrique du Nord avec le monde méditerranéen et subsaharien ? Autant de questions qui sont restées suspendues et qui nécessitent des réponses.
Bien évidement, un tel intérêt nécessite de prendre en considération des méthodes différentes de celles qui ne se basaient que sur des textes anciens, en l’occurrence gréco-latins dans l’objectif d’appuyer l’idéologie qui peut justifier l’appellation coloniale de « l’Afrique française du Nord».
Il faut signaler aussi que si les thèmes que nous présentons ici sont diversifiés et se construisent sur des champs thématiques, repartis en plusieurs parties ; nous les avons, néanmoins, regroupés en un thème transversal et focalisé en général sur les anciens amazighs. Il nous a paru logique d’essayer, en premier lieu de retracer l’origine et l’histoire des toponymes de l’Afrique du Nord avant et pendant les expansions étrangères à commencer par les Phéniciens à la fin du IIème millénaire av. J.-C. Puis, nous nous sommes interrogés sur les origines des anciens amazighs, leur religion et leurs rapports avec d’autres civilisations subsahariennes et méditerranéennes, notamment égyptiennes et carthaginoises.
Ainsi, pour ce faire, il a fallu toucher à plusieurs périodes allant de la protohistoire, voire parfois la fin de la préhistoire jusqu’à la période de l’histoire ancienne, en nous appuyant sur des témoignages littéraires, archéologiques, anthropologiques et linguistiques.
Auteur : Mohamed-Mustapha BOUDRIBILA
Date de publication : 2015
Langue : Française
Nombre de Pages : 286 pages
Editeur : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Université Ibn Zohr – Agadir